selon l Obs
Sigmund Freud et Françoise Dolto auraient-ils inspiré George Lucas pour sa saga galactique ? En tout cas, leurs thèses se retrouvent très largement illustrées.
Difficile de passer à côté de "Star Wars". La saga galactique de George Lucas revient au cinéma ce mercredi 16 décembre avec "Le Réveil de la force". De quoi déchaîner toute une génération marquée par le mythe.
Si l'œuvre a profondément marqué l'histoire du cinéma hollywoodien, elle a également touché les psychologues et psychanalystes. Si bien que les analyses psy de la saga se multiplient aux Etats-Unis comme en France.
A l'occasion de la sortie de l'épisode VII, "L'Obs" se penché sur les concepts psychologiques à l'œuvre dans l'épopée galactique.
FREUD À TOUS LES ÉTAGES
En fabriquant ce mythe universel à partir d'archétypes qui s'adressent à l'enfance, George Lucas touche à l'univers freudien", résume Hugues Paris, psychanalyste, coauteur de "'Star Wars' au risque de la psychanalyse".
L'univers galactique du réalisateur se base sur le concept de Force, sorte de champ énergétique qui permet de faire bouger des objets à distance mais aussi de modifier les pensées des autres. En utilisant ce pouvoir, deux factions s'affrontent : les Jedi, gardiens de la paix qui utilisent le côté lumineux de la Force, et les Sith, leurs ennemis historiques qui préfèrent le côté obscur plus puissant.
"La Force représente la libido de Freud", tranche Arthur Leroy, psychothérapeute à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et auteur de "'Star Wars', un mythe familial". "Le côté lumineux et le côté obscur représentent les pulsions de vie et de mort."
LIRE "Star Wars" expliqué à ceux qui n'y connaissent rien
Les deux trilogies racontent ainsi le parcours initiatique d'un héros (Anakin et Luke Skywalker), confronté à plusieurs étapes successives qui évoquent les étapes que traverse l'énergie sexuelle.
En somme, "Star Wars" illustre le passage de l'adolescence à l'âge adulte. "Les questions du père et du passage à l'adolescence sont récurrentes dans l'œuvre de Lucas, jusque dans 'Indiana Jones'", confirme Hugues Paris.
L'OMNIPRÉSENT COMPLEXE D'ŒDIPE
"Lucas reprend sans le savoir la thématique œdipienne dans les deux trilogies – d'une manière classique dans la première, puis très contemporaine dans la seconde", poursuit le psychanalyste.
Théorisé par Sigmund Freud, le complexe d'Œdipe est devenu central dans la psychanalyse. Il se définit comme le désir inconscient de l'enfant d'entretenir un rapport sexuel incestueux avec le parent du sexe opposé et celui d'éliminer le parent rival du même sexe.
Hugues Paris grossit le trait : "Au fond, la première trilogie raconte l'histoire d'un ado qui veut coucher avec sa sœur et qui, pour ça, doit tuer son père. Dans la deuxième trilogie, le défi est de se construire en l'absence d'une contrainte paternelle."
Arthur Leroy souligne la recherche d'inceste dans la "prélogie" (épisodes I à III) :
Pour le héros Anakin, Padmé est une représentation de sa mère. Il la rencontre déguisée en servante, évoquant sa mère esclave, alors que c'est une reine. D'ailleurs, dans 'L'interprétation du rêve', Freud souligne que la reine est une représentation parentale. Dans ses rêves prémonitoires, Anakin voit tour à tour sa mère puis Padmé, la figure de la femme qui prend soin de lui et va l'abandonner en mourant."
LA RÉCURRENCE DE LA CASTRATION DE DOLTO
Jeu de main, jeu de vilain. "Star Wars" a créé toute une mythologie autour de la main coupée : dans "L'Empire Contre-Attaque" (1980), Luke Skywalker voit sa main tranchée lors de l'affrontement final contre Dark Vador. Une main coupée qui s'est ensuite retrouvée dans tous les films suivants, puis a été reprise par de nombreuses œuvres (en particulier par les films Marvel).
"Cette main coupée est une castration symboligène telle que conceptualisée par Françoise Dolto", explique Arthur Leroy. Le psychologue explique :
Par la frustration de son environnement (l'éducation, les parents, etc.), l'enfant développe des capacités fantasmatiques, symboliques, à l'image du petit garçon de 6 ans qui rêve de conduire une voiture. C'est un moment de construction qui passe par la séparation avec un objet immédiat de satisfaction. C'est la même chose dans 'Star Wars' : chaque main coupée sert à la construction, à donner une leçon."
Ainsi, après avoir perdu sa main dans "L'Empire Contre-Attaque", Luke Skywalker apparaît en Jedi beaucoup plus sage au début du "Retour du Jedi" : il est plus posé, a construit son propre sabre laser et a changé d'uniforme. Il a profité de l'échec de son combat contre Dark Vador pour créer une nouvelle représentation de lui-même. Même chose dans la "prélogie" lorsque Mace Windu se fait trancher le bras quand il enfreint le code Jedi.
Finalement, seul Anakin Skywalker refuse la leçon de la main coupée. "Malgré la perte de son bras dans sa première bataille contre le Comte Dooku [dans 'L'Attaque des clones', NDLR], cela ne l'empêche pas d'enfreindre les règles et de se marier avec Padmé", pointe Arthur Leroy. "Ce n'est que lorsqu'il perd une jambe et ses deux bras [à la fin de 'La Revanche des Sith, NDLR] et qu'il devient une machine, qu'il se voit contraint d'évoluer. Quand on le voit en tant que Dark Vador [à partir de 'Un Nouvel espoir', NDLR], il s'avère beaucoup moins explosif."
"STAR WARS", UN UNIVERS SANS SEXE ?
Il est connu que les Etats-Unis demeurent assez puritains avec les films diffusés au cinéma. Pour autant, "Star Wars" place haut la barre de l'absence de sexe à l'écran. "Le seul mode de reproduction évoqué, c'est le clonage, c'est-à-dire un affranchissement presque houellebecquin du sexuel", souligne Hugues Paris.

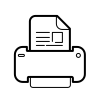
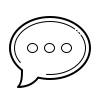







Yorum Yazın